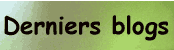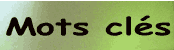La situation actuelle et l’avenir de Copernic




Dimanche 23 janvier 2011
Samedi, AG de la Fondation Copernic. J’y ai repris un rôle actif, au bureau, depuis que notamment sa présidente Caroline Mécary a rejoint Europe-Écologie. Campagne sur les accidents de travail, campagne sur les retraites : on n’a pas chômé. Et je m’y sens bien. Ses animateurs (Willy Pelletier, Pierre Khalfa, etc ) sont de vieux copains de lutte des années 80-90.
Leur ligne d’ouverture a suscité des réticences de la part de certains anciens dirigeants de Copernic. J’avais, avant l’AG, donné mon avis dans un texte déjà sur mon site. Sur la liste de débat interne de la Fondation, le « FASE » Roger Martelli et la NPA Stéphanie Treillet avaient répondu longuement, sur un mode sympathique et constructif.
À l’AG, malgré quelques frottements, la ligne d’ouverture est confirmée : « on n’est plus à l’époque du Non au TCE et de la catastrophe des comités anti-libéraux en 2007 ». Je me risque même à rappeler qu’il était légitime pour des anti-libéraux tels que Caroline ou moi de juger que le TCE était moins libéral que le traité en vigueur (Maastricht-Nice) et donc de voter Oui. À la sortie, le débat reprend aussitôt là où il aurait dû commencer à l’époque : « Mais voter Non ne voulait pas dire qu’on préférait Maastricht-Nice ! On ne voulait ni de l’un ni de l’autre. » Je réponds que, dans ce cas, on fait campagne sur « Blanc bonnet et bonnet blanc ». Voter Oui ou Non, c’était décider, de jure et de facto, lequel de ces deux mauvais traités on préférait.
Je me rends compte qu’il y a là-dedans une question d’âge et peut–être de rapport différent aux institutions dans une histoire politique individuelle. En 1974, ayant à choisir entre Pompidou et Poher, nous avions tous ici décidé de voter blanc ou de boycotter. En 2002, entre Chirac et Le Pen, nous avions tous voté Chirac. Alors, 2005 ressemblait–il plus à 1974 ou à 2002 ? Au fond, c’était là toute la question. Soit on répond : aussi pire l’un que l’autre (comme en 1974), et on vote blanc. Si on répond « TCE mieux que Maastricht » (comme en 2002), on vote Oui, si on répond « Maastricht-Nice mieux que le TCE » – ce qu’argumentait le souverainiste Chevènement — on vote Non.
Un point est en tout cas frappant : l’ouverture du débat sur la sortie de l’Euro. Plusieurs NPA sont en effet inquiets : il faut faire campagne contre la sortie de l’euro, disent-ils, pour faire barrage au risque souverainiste ! Il y a quelques mois, lors de mon débat avec Jacques Sapir (vrai noniste et bon économiste) dans Regard (la revue de Roger Martelli), celui –ci pouvait encore assurer tranquillement que l’on pouvait combattre frontalement l’Europe capitaliste, puisque le risque nationaliste n’existait plus en Europe ! La dynamique de la crise a battu le rappel : oui, nous sommes à bien des égards dans les années 30.
Du coup, rendre public le débat stratégique entre « Europe-Ecologistes » et « gauches de la gauche » devient urgent. Roger, Stéphanie et moi sommes d’accord pour rendre public notre débat et y inviter qui voudra. Le site web de la Fondation ne pouvant être immédiatement mis en « web 2 » (avec un forum de discussion), nous décidons de poster aussi sur le forum du présent billet notre débat sur la liste interne de Copernic.
Je ne reproduis pas ici mon texte de départ, il est là : http://lipietz.net/?article2615. Et je cède la plume sur ce forum à Stéphanie et Roger.

Forum du blog
Il y a 6 contributions à ce blog.
-
Réponses critiques et amicales à Alain Lipietz
Le texte qui suit est une réflexion suscité par la contribution d’Alain sur « La Fondation Copernic à la croisée des chemins ». Je précise que, quelles que soient mes sympathies pour la FASE (Fédération pour une Alternative Sociale et Écologiste), je n’en suis pas membre. Je me définis toujours comme « communiste refondateur » (je tiens à l’intrication des deux termes) et j’appartiens à l’Association des Communistes Unitaires. Politiquement, je continue d’être désolé de la dispersion des forces critiques et ne me sentirai pleinement membre que d’une dynamique politique rassemblant tout le champ de l’alternative, y compris donc l’extrême-gauche et les écologistes. J’ajoute que je ne suis pas plus « ancien » de Copernic qu’Alain et que je ne me suis pas inquiété de « l’ouverture ». Moi qui me suis donné entièrement à la justification d’un non de gauche au TCE, un Non à l’Europe libérale prélude d’un Oui à l’Europe sociale, démocratique et écologiste, j’ai toujours considéré que le Oui d’Alain ne nous plaçait pas irrémédiablement de part et d’autre d’une barrière. Qu’il soit « revenu » est à mes yeux un non-événement : pour moi, il n’était pas parti.
Comme d’ordinaire, Alain Lipietz a le mérite d’énoncer son point de vue avec franchise et avec clarté (1). C’est la raison pour laquelle j’aime le lire et débattre de ses idées, que je sois d’accord avec lui (c’est souvent le cas depuis bien longtemps) ou que je ne le sois pas (ce fut le cas sur le projet de TCE et c’est le cas sur une grande part de ce qu’il dit dans son petit texte). C’est ainsi : il est des gens avec lesquels je prends parfois davantage de plaisir intellectuel à disputer que je n’en ai à acquiescer avec d’autres, a priori plus proches de mon point de vue. Alain Lipietz est de ceux-là ; j’ajoute que Patrick Viveret en est aussi.
Cela me permet au passage, une toute dernière fois, de rappeler que je n’ai pas récusé la signature du texte proposé par Libération par refus pudibond de discuter avec qui que ce soit. Je trouvais seulement inopportun de signer un texte qui, quelles que soient les intentions de tel ou tel, s’inscrit dans un cadre général de pensée et une configuration d’ensemble (celle que révèle le panel des Forums) que je crois plus dangereux que propulsifs. À mes yeux, ne pas signer ne dit pas le refus de débattre, y compris dans les initiatives de Libé, mais celui d’être coproducteur d’une démarche dont la philosophie générale et le déroulé risquent d’aller massivement à rebours de ce que, me semble-t-il, Copernic devrait vouloir plus que tout.
J’en viens donc au fond de ce qu’avance Alain. Dans ce qu’il écrit, de quoi puis-je convenir ? De ce que l’alternative ne se réduit pas à la critique de ce qui est, mais vaut d’abord par la capacité d’opposer quelque chose à ce que l’on combat. De ce que la crise contemporaine du capital ne se réduit pas à celle de ses fondements économico-sociaux. De ce que le désir de transformation-rupture ne se réduit pas à la répétition des thématiques anciennes de la révolution. Jusque-là, tout va bien… Mais c’est à partir de là que les problèmes commencent.
Alain dit que, à la dimension économico-sociale de la crise, il faut « ajouter » sa dimension écologique. De fait, il tend à penser que cette dimension devient à ce point structurante qu’elle requiert un changement global de « paradigme », et donc un déplacement de dominante de « couleur » dans la large palette de l’alternative. Je ne partage pas cette vision des choses. L’évolution capitaliste des dernières décennies ne pousse pas seulement à « ajouter » des dimensions, mais à penser de façon renouvelée leur articulation. Le mérite du « néolibéralisme » a été peut-être, intellectuellement tout au moins, de rappeler ce que l’on sait en fait depuis le départ : que le capitalisme n’est pas seulement un « mode de production » (au demeurant « productiviste » par nature) ou un ensemble de techniques « économiques », mais un entrelacs de rapports sociaux, une manière de « faire société ». Il est un complexe social reposant sur l’exploitation (l’appropriation privative de la survaleur), enchâssé dans des procédures de domination (l’ensemble des pratiques et des structures qui placent une majorité d’individus en position de subordination), dont la logique profonde est la séparation des individus sociaux subordonnés et de leurs actes (ce que l’on appelle aussi l’aliénation). Le capitalisme, ce n’est pas de l’exploitation lestée du productivisme et de la domination, c’est leur entrelacement qui, au final, contredit de façon absolue le développement des capacités humaines.
Sur la longue durée, l’évolution des sociétés marchandes et du capital a plutôt produit de la dissociation des « instances » (l’économique se sépare du social, du politique, du culturel…). J’ai un peu l’impression que, depuis trois décennies (mondialisation plus libéralisme intégral), nous connaissons à l’inverse des recompositions d’envergure qui font s’imbriquer de plus en plus des enjeux indissociablement économico-financiers, socio-juridiques, politico-institutionnels et psychologico-éthiques. La question de la critique contemporaine n’est donc pas pour moi d’ajouter de l’écologique à l’économique, du sociétal au social, de l’immatériel au matériel, ou de l’éthique au financier. C’est de penser dans leur articulation générale les différentes dimensions constitutives du capitalisme contemporain ; c’est, par voie de conséquence, penser de façon articulée les dimensions de l’alternative, pour qu’elle parvienne à un degré de cohérence (je dis bien : de « cohérence », pas de « totalité ») au moins aussi performante que celle du capital contemporain.
Pour parvenir à cette intelligence nouvelle du « tout social » que constitue le capital, je conviens qu’il faut de la novation. Qu’une part du vieux marxisme et de sa « surdétermination » par l’économique soit inopérante, je veux bien l’accepter, sous réserve d’inventaire sérieux. Qu’une part de la vieille idée républicaine soit incapable de prendre en compte les exigences d’une mise en commun qui ne soit pas avant tout étatique et éradicatrice, je peux le percevoir aussi sans problème. Que la vieille culture d’une rupture au singulier (le moment privilégié de la « prise du pouvoir ») conduise au changement étatique par en haut et, de fait, aboutisse à la reproduction de l’aliénation, je ne peux que le redouter. C’est en tout cas la raison pour laquelle, dans ma vie intellectuelle et militante, je n’ai jamais séparé l’affirmation de ce que je voulais (je ne surprends personne en rappelant que ma famille de référence est le communisme) et la conviction que ce que je désirais nécessitait d’être « refondé », de la cave au grenier.
Mais si tout cela est vrai et ne m’éloigne pas de ce que dit Alain Lipietz, il reste quelque chose de fondamental qu’Alain me semble sous-estimer. Si ce capitalisme contemporain devient de plus en plus intégré, le dépassement de ses limites (y compris celle du « productivisme ») oblige à penser à frais nouveaux la rupture avec ses visées et avec ses mécanismes. Sans doute la révolution ne peut-elle plus, après l’échec du soviétisme et les butoirs de « l’État-providence », se penser dans les termes du XIXe siècle ou du premier XXe siècle. On ne remplace pas le marché par l’État, Hayek par Keynes ou par Brejnev… Mais les dilemmes de la rupture ou de l’adaptation restent pertinents. Ou l’on « abolit-dépasse » les logiques existantes dans les faits et pas dans les mots ; où l’on s’accommode de leur domination. Y parvenir se fait et se pense en termes de processus complexes et pas en termes de moments plus ou moins magiques ; mais si la rupture aujourd’hui se décline à la fois au singulier et au pluriel, elle s’assume. Ou alors, on laisse « l’historicité » au capital…
Dans les dernières décennies, j’ai pu me trouver en désaccord avec des communistes, des républicains, des keynésiens radicaux, des rejetons divers du bolchevisme, j’en passe et des meilleurs. Il n’en reste pas moins que j’ai toujours considéré que j’avais en commun avec eux l’essentiel : le désir de rupture, et d’une rupture qui, d’une façon ou d’une autre, cherche à se bâtir de façon intégrée, entremêlant l’économique, le social, le politique, l’institutionnel et l’éthique. Ce n’est pas que je veuille discuter seulement avec eux : j’ai même commencé en disant que, parfois, cette discussion nécessaire m’ennuyait davantage que celle avec d’autres, théoriquement moins radicaux.
La radicalité alternative, d’ailleurs, ne se décrète pas, elle se construit. Je ne considère pas la pensée d’Alain Lipietz comme moins intéressante pour une pensée de rupture, au prétexte qu’il a soutenu le projet de TCE alors que Copernic l’a combattu. Mais nous sommes confrontés à un problème de positionnement d’ensemble : globalement, Copernic me paraît devoir être plutôt du côté de ceux qui, considérant que le modèle social dominant est porteur d’inhumanité, entendent travailler à de la rupture avec ce modèle et à bâtir patiemment la pensée collective de cette rupture. Je ne suis pas souverainiste : je pense que cette piste ne permet pas de penser la rupture dans un monde interpénétré. Cela ne m’empêchera pas, à tel ou tel moment, d’être plus proche d’un souverainiste franchement « antilibéral » ou « anticapitaliste » (j’ai du mal à distinguer les deux termes aujourd’hui) que d’un « fédéraliste » qui considère que la régulation « douce » du marché est un moindre mal et que la concurrence s’apprivoise, sans qu’il faille se demander comment à terme s’en passer. Je ne suis pas « étatiste », parce que je ne crois pas que l’on surmonte les conséquences d’un marché qui déchire les individus par les vertus d’un État administré qui les domine ; mais je me sens plus proche d’un « étatiste » qui défend les services publics et leur démocratisation, que d’un « antiétatiste » qui m’explique qu’il faut lutter contre les corporatismes et assimiler la « culture du résultat » dans les services publics. Ce qui, en même temps, ne m’empêchera pas d’apprécier toute avancée qui, même dans le cadre du système, permet effectivement du mieux-être, le plus durable possible. Préférer les ruptures à l’adaptation n’a rien à voir avec le tout ou rien.
En bref, le débat ne me semble pas être, comme le suggère Alain Lipietz, entre les « anciens » et les « modernes », ou entre les partisans du repli sur soi et les tenants de l’ouverture. Il est autour de ce qui identifie Copernic : de la novation assumée dans la définition d’un projet contemporain de rupture et d’alternative critique à l’ordre dominant ; de la méthode collective patiente pour produire cette novation (qui n’implique nulle « table rase »). Tout ce qui est au-delà n’est pas hors-sujet ; il n’en est pas moins second par rapport à l’essentiel. De qui devons-nous nous sentir les plus proches ? De toutes celles et ceux qui, consciemment, critiquent radicalement l’ordre existant et n’acceptent pas sa fatalité historique. Les « alliés » sont de ce côté-là. À partir de là, l’enjeu fondamental n’est pas de se faire plaisir et de se rassurer entre nous. Il est de parvenir à quelque chose qui se rapproche de l’hégémonie conquise pour les idées de transformation radicale ; et pour cela il faut penser ladite transformation dans les conditions de notre temps. Hors de cela, nous sommes des aiguillons périphériques de la pensée dominante ou des porteurs d’eau. Je sais que, à Copernic, ce n’est l’ambition de personne.
(1) Il y a une seule chose que je n’aime pas du tout, mais pas du tout : le petit bout de phrase où il écrit, à propos des « séductions du fascisme et du stalinisme », « les secondes étant en un sens beaucoup plus graves ». Sans doute le grand tort du stalinisme aura-t-il été, comme le précise Lipietz, de contribuer à ternir « l’espérance du socialisme ». Je n’en souhaite pas moins que l’on se retienne d’employer des comparaisons dont on sait les effets désastreux et dont je souhaite qu’elles n’aient pas leur place à Copernic.
Roger Martelli
Lundi 24 janvier 2011 à 11h52mn57s, par Roger Martelli
lien direct : http://lipietz.net/?breve413#forum3863
-
Cher Roger
Je te remercie pour l’attention que tu as bien voulu apporter à mon texte et ta réponse circonstanciée, début je l’espère d’un débat prolongé.
S’agissant de ce qui motivait mon texte, je n’épiloguerai pas 107 ans : Willy a eu raison de ne pas brusquer les choses en n’engageant pas Copernic dans la co-organisation d’un débat entre Fondations proposé par Patrick Viveret. J’aurais été pour, tu étais contre. Et nous sommes d’accord qu’il ne s’agissait pas seulement de « débattre ou pas », mais d’être « coproducteurs d’une démarche de débat » dont je pense, pour les raisons que je dis dans mon texte, qu’elle est aujourd’hui plus utile qu’embarrassante. Le débat est donc sur ce qui t’embarrasse.
Nous avons eu et aurons des années pour en discuter. Je ne demande pas à la fondation Copernic de devenir écolo : nous créons actuellement une fondation de l’écologie politique pour cela. Et je ne prétends pas te convaincre de passer du paradigme rouge au paradigme vert. Simplement, il me semble désormais un peu court et dangereux de réduire notre objectif commun (ceux que nous poursuivons ensemble, rouges et verts, dans Copernic) à la critique de l’aspect libéral du capitalisme actuel.
C’est d’autant plus important que, comme tu le dis très justement, tous les aspects sont entrelacés. Cependant, chaque mode de production, et chaque modèle de développement particulier au sein d’un mode de production, connaît une forme de crise spécifique à sa structure propre (à son « entrelacement » spécifique, si tu veux), crises où s’affirment, avec plus ou moins de force selon les cas, les aspects économiques, sociaux ou écologiques. Par exemple, comme l’a montré Guy Bois, la grande crise du féodalisme que représente la Peste noire (et la fluctuation biséculaire qui l’a suivie) avait évidemment des racines économico-sociales (surexploitaion seigneuriale) mais aussi écologiques (quasi achèvement du défrichement de l’espace européen, excès de la vaine pâture) et sa manifestation principale a été une crise écologique (la peste elle-même) !
Même à s’en tenir à l’économie, les crises capitalistes, comme Marx l’a montré , peuvent venir soit du côté « baisse tendancielle du taux de profit » (exemple : la crise du modèle fordiste dans les années 1975-1985) ou du coté « surproduction/sous consommation » (crise des années 1930). Et il est assez important de savoir dans quelle situation nous sommes, car la social-démocratie et le keynésianisme constituent une issue possible dans le second cas , pas dans le premier cas.
Je pense (cf http://lipietz.net/?article2417 et http://lipietz.net/?article2579 ) que nous sommes dans le cas « surproduction » (trop de profits, pas assez de salaire ) mais que pourtant la solution social-démocrate à la Roosevelt n’est pas suffisante, contrairement à ce que semblent croire les « économistes atterrés ». La dimension écologique de la crise actuelle est telle que la « relance » par le crédit et la consommation n’est plus possible. Autrement dit (et contrairement à ce qe pensait Marx), les crises « à la Ricardo »sont de retour, non pas, comme le pensait Ricardo , parce que le capitalisme doit aujourd’hui mettre en valeur « les plus mauvaises terres » (encore que ce soit à peu près ce qui se passe dans le domaine de l’énergie) mais parce que le productivisme a fini par saccager… même les meilleurs terres !
On peut en débattre, mais il me semble que la réalité du développement de la crise actuelle (ne serait-ce que la persistance de la crise alimentaire : cf http://www.liberation.fr/economie/01012314293-la-bombe-a-retardement-alimentaire ) donne plutôt raison à ceux qui pensent que la « cohérence » de la solution à la crise passe par la prise en compte au premier chef de la contradiction « humanité/nature ». Même dans le cadre d’une solution qui, en termes strictement socio-économiques, passerait pour rooseveltienne (redistribution fiscale et salariale + renforcement des syndicats + régulation financière + capitalisme d’Etat). Un bon New Deal est un Green Deal.
Mais, cher Roger, ceci n’a rien à voir avec une contradiction « le vieux / le nouveau » ! Comme je l’ai rappelé en citant Guy Bois sur la Peste Noire (1976 !), et la réalité et les marxistes ont connu des crises écologiques depuis bien longtemps ! Si ça se trouve, après la découverte d’une issue éco-social-démocrate à la crise actuelle, le capitalisme connaîtra une crise finale en 2050 qui passera principalement par la dimension économique J !
Tu viens de le remarquer, je suis attentif au « dilemme rupture ou adaptation ». La différence avec toi, c’est que j’admets que certaines ruptures (comme le passage au capitalisme rooseveltien, fordiste, keynésien, ou social de marché, ou appelle-le comme tu veux), pourtant extrêmement violentes (des grèves générales, des guerres civiles et une guerre mondiale de 1930 à 1945, excusez du peu) nous sortent d’un modèle de capitalisme, mais pas du capitalisme lui-même.
Rompre avec le libéralisme, ce n’est pas rompre avec le capitalisme. Ou alors, je suis plus exigeant dans ma définition du « socialisme ». Il est vrai que les sociaux-démocrates suédois pensaient avoir réalisé le socialisme en Suède, et que les auteurs du Programme commun pensaient que la nationalisation de toutes les banques et des très grandes entreprises (qui fut réalisé en 1981 !!) caractériserait la sortie du capitalisme !
Il faut donc rajouter un cran dans la hiérarchie « adaptation/ rupture ». Appelons-le « transformation » ? Cela rend la rhétorique de la « rupture » un peu plus difficile à utiliser dans la polémique. En réalité, ce débat a déjà eu lieu, lors du précédent changement de modèle capitaliste (lors du passage du fordisme au libéral-productivisme). On parlait alors d’ « alternative ». Alternative qui n’était pas nécessairement « alternative au capitalisme ». Vois comment, en 1986, j’avais défini cette alternative : http://lipietz.net/?article466 . Aujourd’hui, bien des ex-partisans de « l’adaptation » au libéral-productivisme ne seraient pas loin de se rallier à l’alternative telle que je la décrivais alors : qu’en penserais-tu aujourd’hui ?
Il est cohérent avec ton refus de faire cette distinction, entre capitalisme en général et capitalisme libéral en particulier (quand tu écris : « « Antilibéral » ou « anticapitaliste » : j’ai du mal à distinguer les deux termes aujourd’hui. »), que tu opposes sans moyen-terme « rupture » et « adaptation », au risque d’assimiler toute crise du capitalisme à sa « crise finale ». Mais franchement, cela retarderait-il tellement la rupture finale, que d’adopter certaines réformes anti-libérales et anti-procductivistes, et d’en discuter de manière organisée avec d’autres fondations progressistes ?
Et peut-être aussi que tu refusas en 2005 de réformer l’Union Européenne, parce que toute réforme serait une adaptation, qui permettrait au capitalisme de se survivre quelques années de plus, un peu comme la LCR refusait la taxe de Tobin (cf http://lipietz.net/?article214 ). Je pense au contraire que le dépassement de l’Etat-Nation dans une Europe fédérale (la rupture avec l’Europe intergouvernementale de Masstricht-Nice) exigeait des ruptures si douloureuses avec cette forme d’hégémonie bourgeoise, profondément ancrée dans les consciences populaires, que représente la Nation (combattue jadis par les marxistes avec raison), que le passage de Nice au TCE était peut-être encore trop brutal… Le désaccord entre nous serait alors purement tactique : comment arriver au même résultat stratégique, commun à Kant, Victor-Hugo, Marx et Jaurès : les Etats-Unis d’Europe, étape vers la République Universelle ?
Plus inquiétante est en revanche, à mes yeux, l’alliance que tu sembles recommander avec un « souverainiste anti-libéral » (typiquement qui ? Le Pen ? ou « seulement » Pasqua et Dupont-Aignan ? ) contre « un « fédéraliste » qui considère que la régulation « douce » du marché est un moindre mal et que la concurrence s’apprivoise, sans qu’il faille se demander comment à terme s’en passer. » (Typiquement qui ? Chirac ? ou « même » Patrick Viveret ?) . Je suis de ceux qui, en un quart de seconde, ont pensé qu’il fallait voter Chirac contre Le Pen (mais j’ai mis trois semaines à conclure qu’il fallait voter le TCE contre Nice). Et, comme je l’ai montré à de nombreuses reprises, le souverainisme national, sans rétablissement des bannières douanières entre la France et la Belgique, C’EST le libéralisme. Raison pour lesquelles le Wall Street Journal, le Financial Times, Madelin et Fabius ont fait campagne pour le Non, c’est à dire le maintien de Maastricht-Nice.
Mais plus profondément : serais-tu par hasard contre l’effort de réguler le marché ? Contre l’idée qu’une régulation douce serait « un moindre mal » que pas de régulation du marché du tout ? Ou serais-tu par hasard pour un post-capitalisme « se passant complètement de la concurrence », c’est-à-dire totalement monopoliste et planifié ? Ou ta plume est-elle allée au delà de ta pensée ?
Ce qui me conduit à ta remarque en note. Peut-être as-tu compris mon incidente sur la « gravité » respective du fascisme et du stalinisme (2 des 3 réponses des années 30 au mythe du pouvoir auto-régulateur du marché , comme disait alors Polanyi) comme la reprise du débat imbécile sur les crimes du communisme comparé comptablement à ceux du fascisme. Je pense, d’une certaine façon comme Primo Levi, que les crimes des fascismes italiens et espagnols sont de l’ordre de gravité objective de ceux des gouvernements staliniens, mais que ceux du nazisme sont philosophiquement incommensurables. Mais là n’était pas le sens de ma remarque.
En 45 ans de militantisme « à gauche », personne ne m’a reproché les crimes de Hitler, Franco ou de Mussolini. Mais toute ma vie militante a été empoisonnée par ceux de Staline, de Mao, de Tito ou de Castro. Nous ne sommes pas responsables des crimes du fascisme. En revanche nous sommes quelque part responsables (même les trotskistes) des crimes commis au nom du socialisme. C’est-à-dire que nous avons à répondre à un Vietnamien , à un Khmer qui nous demande « Qu’as tu fais au moment où nos bourreaux s’apprêtaient à prendre le pouvoir » ? Cette question me hante encore aujourd’hui (cf sur ces deux pays : http://lipietz.net/breve412). Ce n’est pas une question de battre sa coulpe. Mais d’éviter le retour du pire : le discrédit sur toute forme d’espérance.
En ce sens, je persiste et signe : « La forme acritique d’anti-libéralisme [des hétérodoxes de l’Entre-Deux-Guerre] n’a guère préparé l’opinion publique française à résister aux séductions du fascisme et de stalinisme, les secondes étant en un sens beaucoup plus graves, car avec les crimes du stalinisme c’est la grande espérance du socialisme qui sera condamnée par l’histoire du XXè siècle. »
Alain Lipietz
Lundi 24 janvier 2011 à 18h21mn04s, par Alain Lipietz
lien direct : http://lipietz.net/?breve413#forum3864
-
C’est un plaisir, Alain, de prolonger le débat avec toi.
Tu as raison de souligner que, dans les articulations d’un « mode de production », telle ou telle dimension (économique, sociale, politique, anthropologique…) peut prendre une place fonctionnelle prépondérante. Et je conviens avec toi que, dans le mode de production capitaliste, la question du rapport homme/nature devient cardinal, tout simplement parce que se conjuguent avec lui la croissance démographique (la demande sociale et donc l’acheteur), l’expansion mercantile (la réalisation de la survaleur dans l’échange et donc le vendeur) et la production élargie (la valeur d’usage support de la valeur et donc la multiplication infinie du produit marchandise). C’est par cette conjonction, au cœur du capitalisme comme forme exacerbée et « totale » de l’économie marchande, que l’on passe de l’économie de la rareté à celle de la gabegie et de la progression technique (économie des ressources, maximisation des résultats) au productivisme (le déséquilibre des ressources et du résultat).
Mais si cela est vrai, il n’en reste pas moins deux aspects que tu me sembles sous-estimer. Tout d’abord, pour le capitalisme, le moteur du déséquilibre reste à tout moment dans la volonté d’appropriation de la survaleur (ou « plus-value », ne nous enfermons pas ici dans la querelle des notions) et, pour cela dans l’universalisation de la forme marchandise. C’est parce qu’il y a un problème historique de valorisation du capital, dans les années soixante, que l’on cherche à substituer le travail mort (la machine, le capital fixe) au travail vivant ; que l’on cherche à étendre l’espace de la marchandisation, géographiquement et qualitativement ; que l’on cherche à se débarrasser de tout ce qui freine la fluidité de la marchandise (y compris de la marchandise travail) ; que l’on s’engouffre dans toutes les opportunités de l’informationnel (de la financiarisation à la virtualisation). Il ne faut pas se tromper dans le surinvestissement du terme « libéral ». Il ne désigne pas une « nature » du capital contemporain : le capital est par fondation libéral ; et s’il fallait chercher de l’originalité à la phase contemporaine, on la trouverait plutôt dans les dominantes du financier, de « l’immatériel », de la mondialisation directe de flux. L’insistance sur le « libéral », ou plutôt le « néolibéral », met l’accent sur la dimension volontaire de la reproduction du capital : on est passé historiquement d’un capital contraint à accepter de la régulation et de la distribution (fussent-elles à la marge) à un capital qui n’en veut plus.
Le deuxième aspect que je retiens pour ma part tient à la crise. Tu dis : dans la crise actuelle le rapport homme/nature devient premier, alors qu’il ne l’était pas dans les crises précédentes. J’ai l’impression quant à moi que ce qui caractérise la crise actuelle n’est pas dans la mise au premier plan d’une dimension, mais dans la multiplication et dans l’entrelacement des dysfonctionnements structurels. « La » crise n’est rien d’autre que l’imbrication « des » crises qui touchent à la fois aux technostructures (la définition moderne de l’efficacité), aux rapports sociaux (l’allocation des ressources et les statuts), à la maîtrise financière (la déconnection quasi complète du stock financier et de la richesse réelle), aux structures de pouvoir (depuis 1975 domine le thème de la crise de l’efficacité démocratique et de la loi et du besoin de « bonne gouvernance » et de contrat) et aux dimensions socio-psychologiques (comment penser la dialectique de l’individu et du collectif).
C’est cela qui fait à la fois l’originalité, la profondeur déstabilisante et sans doute la durabilité de la crise actuelle. À aucun moment dans le passé, la crise n’a atteint cette charge à proprement parler « systémique », à la fois plus multiple et plus articulée, finalement plus « rhizomique » que « concentrique ». Mais si la crise est globale, son issue doit se penser d’emblée dans sa globalité et non pas à partir d’une seule de ses composantes, pas plus l’écologique, que l’institutionnelle ou que la financière. En cela, l’issue doit bien se penser comme « politique » au sens fort (et aujourd’hui non dominant) du terme : l’ensemble des procédures par lesquelles une société envisage, non pas de se soumettre à une fatalité extérieure, celle des contraintes inexorables des marchés ou de l’intérêt général édicté par l’État « séparé », mais de se guider par la mise en commun assumée, délibérée, décidée et évaluée en permanence.
Bien sûr, cela nous conduit à la question de la rupture et de l’adaptation. Il est inutile, me semble-t-il, de s’enfermer dans des faux débats. Il ne s’agit pas aujourd’hui de savoir s’il faut redouter toute avancée partielle, au motif qu’elle retarde le moment magique de la révolution. Le problème qui nous est posé se concentre en deux interrogations. Dans l’état actuel de crise (non pas « finale » mais « systémique ») y a-t-il place pour de la réforme globale à l’intérieur du système ? S’il peut y avoir des avancées, globales ou partielles, radicales ou plus modestes, elles sont possibles à quelles conditions ?
À la première question je tends à répondre par la négative, tout simplement du fait de la nature intégrée de la crise et des crises que nous vivons. De fait, ce qui se dessine comme évolutions internes possibles me semble bien loin du keynésianisme des années trente et quarante du siècle dernier. Il est vrai que, depuis quelques années, le discours libéral « pur » bat quelque peu de l’aile. La Banque mondiale, après avoir écarté Stieglitz, n’en a pas moins écorné elle-même en partie cette « fin de l’Histoire » qu’était censé être le « consensus de Washington ». Qui met-on à la tête des organes de supervision générale ? Lamy et Strauss-Kahn : ce n’est pas sans signification. Symboliquement, les USA passent de la symbolique Bush à la symbolique Obama. Mais justement, où est le résultat ? La ligne OMC reste à la libéralisation rigoureuse des échanges internationaux (panne sur le dossier alimentaire) ; on a vu la gestion FMI de la Grèce ; la révolution Obama est mal en point ; à l’échelle internationale, les Objectifs du Millénaire ne seront pas atteints. S’il existe à ce jour un discours sur la « régulation », il n’est pas réformateur au sens ancien, « social-démocrate » du terme. Au mieux, il est « démocrate » : un zeste de régulation juridique et de redistribution à la marge, pour assurer l’ordre social et pour créer les bases de la bonne gouvernance, rassemblant les élites autour du consensus fondamental de la concurrence et de la libre entreprise, le service public réduit au statut de service minimum, de service pour les pauvres.
Comment s’étonner de cette modération de souche « sociale-libérale » ? La crise est désormais mondialisée et systémique, avons-nous dit. Et s’il faut revenir aux années trente, allons jusqu’au bout ? Qu’est-ce qui faisait alors partie du « contexte » ? Une classe ascendante, un mouvement ouvrier en expansion, le grand rêve de la « Sociale » et l’existence de l’URSS et du « mythe soviétique ». Je pousse le raisonnement à la limite : pourquoi y a-t-il eu de la « réforme » vraie dans les années trente et quarante ? Parce qu’il y avait une pression énorme de la « révolution », quel que soit le jugement que les uns et les autres pouvons porter sur telle ou telle composante de la « révolution » d’alors. Paradoxe apparent : il y a de la réforme, parce que les révolutionnaires savent donner le ton.
C’est là que me paraît être le problème contemporain. Ce n’est pas qu’il manque d’éléments pour constituer l’immense force de pression qui contraigne le système à dépasser le face-à-face contraint des « ultralibéraux » et des « régulateurs » timides. Mais, à ce jour, ces ruisseaux innombrables de la contestation du système ne sont pas mouvement alternatif. À partir de là, je ne vois pas d’objection en soi à ce que se mènent des plages de discussion avec toutes les branches imaginables de la régulation. Mais à deux conditions : qu’elles ne s’inscrivent pas dans un cadre entérinant de facto la version la moins ambitieuse de la transformation (que l’hypothèse ne soit pas contredite) ; qu’il soit évident que notre priorité est dans la structuration à terme d’une alternative « vraie ».
Ce qui me navre dans la logique actuelle de l’Union européenne (pas la logique sur le papier ; la logique de la pratique instituée autour de Lisbonne) c’est qu’elle est une machine à éradiquer l’alternative. Ce qui m’effraie dans la structuration actuelle du débat politique (les forums de Libé en font partie) est qu’elle fonctionne à la marginalisation structurelle de tout courant qui s’inscrit peu ou prou dans la vieille tradition française de la révolution. Que cette tradition doive de renouveler structurellement, en profondeur, est une évidence sur laquelle je ne reviens pas ici. Qu’elle disparaisse serait une tragédie. La priorité est donc de penser la rupture et de construire la dynamique qui, seule, la rendra possible. Hors de cela, il n’y aura rien. Ni rupture-transformation, ni même réforme.
C’est autour de cet enjeu que se tissent des réseaux et que se nouent des alliances. Dans le mouvement qui combat l’orientation ultralibérale du capitalisme contemporain, certains pensent encore que le seul véritable antidote du marché libre est l’État. Ils sont plus ou moins « étatistes », « républicains », « néokeynésiens » ; ils superposent plus ou moins « public » et « étatique », bien commun et propriété d’État ; ils préfèrent l’uniformité à l’inégalité et confondent le commun et l’unique. Ils se trompent ? Je le crois. Mais je crois qu’il est plus facile, dans le débat et l’expérience pratique des luttes, de dépasser les limites d’une certaine pensée antilibérale que de passer d’un parti pris « adaptateur » à un engagement de rupture. En bref, il me paraît plus aisé d’assouplir un républicain rigide que de radicaliser un libéral-libertaire. Il est bien sûr des cas limites. Tu cites Viveret. Je crois que sa pensée fluide peut être absolument compatible avec un engagement de rupture avec l’orientation dominante du capitalisme contemporain ; elle peut aussi contribuer à l’affinement d’une pensée « démocrate » de la régulation molle. Tout dépend du contexte général de la discussion et de l’équilibre qui se dessine sur le plan des idées. Pour ce qui est du débat européen de 2004-2006, je persiste dans mon désaccord d’appréciation avec toi. Le camp du Non était composite, comme l’était celui du Oui ; les Oui et les Non n’étaient pas équivalent les uns aux autres. Mais alors que la dominante du Non à Maastricht était plutôt souverainiste (la conjonction de Chevènement et de Seguin), la dominante du Non au TCE était structurée par la question de la concurrence libre et non faussée, des droits sociaux et des services publics. Le parfum général, au fond, avait glissé de la souveraineté nationale à la souveraineté populaire, ce qui n’est pas du tout la même chose. Je n’ai jamais vu dans ton Oui un glissement vers le libéralisme ; mais j’ai considéré alors que ton juste désir d’Europe et ta peur du repli hexagonal te conduisaient à sous-estimer que, pour la première fois depuis bien longtemps, le débat européen portait enfin sur le fond : quelle Europe voulons-nous, de quelle Europe ne voulons-nous pas ?
Je termine (provisoirement) par un petit mot sur la question de la comparaison du stalinisme et du fascisme. Ne crois pas, Alain, que je ne comprends pas ton problème. Tu dis que ta vie a été empoisonnée par la question du stalinisme. Que devrais-je dire ? Je persiste à vouloir être communiste et je suis devant cette tragédie : des communistes, au nom même du communisme, ont accompli des crimes qui contredisent absolument l’idéal fondateur et rien, ni dénégation, ni silence, ni repentance ne pourront effacer ce qui reste à la fois compréhensible et mystérieux. Je veux simplement rappeler ce qui devient peu à peu une évidence dans la communauté historienne, par-delà les différences des uns et des autres : la comparaison du communisme et du fascisme, voire celle du stalinisme et du nazisme n’est pas une aide à la réflexion mais un enlisement par ailleurs moralement contestable ; le concept de « totalitarisme » peut obscurcir plus qu’il n’éclaire la compréhension du XXe siècle tout entier. Ne baissons pas la garde dans l’analyse vigilante de toutes les dérives inacceptables qui ont pu contredire le combat émancipateur. Mais n’oublions pas que, dans l’amalgame entre les deux grands phénomènes marquants du XXe siècle, il y a avant tout le désir de laisser entendre que l’exercice de la volonté en politique est en lui-même porteur de démesure et donc criminogène. Mieux vaut laisser libre place à la main de Dieu ou à celle du marché. Comme le disait Furet, les antilibéraux ont tort de ne pas voir que capitalisme et démocratie sont indissociables. Je n’ai pas envie d’accepter ce postulat.
Salut et fraternité.
Roger Martelli
Lundi 24 janvier 2011 à 23h54mn09s, par Roger Martelli
lien direct : http://lipietz.net/?breve413#forum3865
-
Cher Roger , on avance, on converge !
1. Sur la caractérisation du type de capitalisme en cours (et en crise)
D’accord sur le fait que ce qui caractérise le capitalisme libéral actuel par rapport au « fordisme » d’Après-guerre, c’est évidemment le recul des régulations, en particulier celles qui protégeaient la force de travail. En ce sens, le capitalisme d’avant 80 était « préférable ». Son existence a d’ailleurs montré qu’un autre capitalisme est possible (que le modèle libéral).
Naturellement , ce capitalisme libéral pousse à des niveaux sans précédent l’extraction de plus value, d’abord par la masse vertigineuse de salariés qu’il a désormais mis au travail (en Chine, en Inde), ensuite par le taux d’exploitation qu’il y réalise (un ouvrier chinois d’aujourd’hui est mieux payé que celui de La condition humaine, mais il est beaucoup plus productif).
Toutefois, attention : j’ai un peu l’impression que ta façon de « rester marxiste » est d’insister sur l’extraction de plus-value sur le dos du travailleur. Marx lui-même avait pourtant fait observer : « Il est faux de dire que le travail est la source toute richesse. Le travail n’en est que le père , mais la Terre en est la mère. » ( Critique des programmes d’Erfurt et de Gotha). Avertissement qui n’aura servi à rien : le mouvement ouvrier s’engouffrera pour plus d’un siècle dans le productivisme et la religion des forces productives.
Aujourd’hui la « ponction capitaliste des richesses de la Terre » est le facteur de crise le plus grave, en un double sens. Il bloque une issue simplement distributrice (rooseveltienne, sociale-démocrate) à la crise, même en Chine (pays où le taux de plus-value est sans doute maximal). Il faut réduire le taux de plus-value ET l’empreinte écologique. Sur ce point nous sommes dejà d’accord : il faut prendre en compte « l’entrelacement », comme tu dis, des deux aspects.
Mais il y a une différence de temporalités, car la pression d’exploitation sur le travail joue « en flux » et la pression d’exploitation sur la Terre joue « en stock » : les dommages exercés sur la Terre sont irréversibles. C’est un des arguments avancés par les communistes comme Jacque Perreux (ex trésorier de la campagne Bové) pour s’engager dans Europe-Ecologie, et c’est ce qui explique le « réformisme radical » de l’ écologie politique : nous n’avons pas le loisir d’attendre la Révolution. Cf http://lipietz.net/?article2548
2. Sur la possibilité d’un capitalisme « préférable » (moins libéral, moins productiviste)
J’emploie cette expression provocatrice, car au fond c’est ça qui coïnce psychologiquement : reconnaître qu’on peut sortir du libéralisme sans sortir du capitalisme, c’est reconnaître qu’un autre capitalisme est possible, ce que toute l’histoire a montré depuis L’impérialisme, stade suprême…, et qu’en plus (horreur absolue ! ) il peut être « préférable » (ce que chacun admet, mais seulement rétrospectivement.).
Tu sembles répondre d’abord clairement par la négative, mais là on est vraiment dans l’acte de foi (toi et moi). La question revient à ceci : si nous ne savons pas abolir le capitalisme, pouvons-nous du moins lutter pour un capitalisme mieux régulé, comme celui que nous regrettons toi et moi d’avoir perdu (même si nous le combattions, toi et moi et avec raison sous De Gaulle et Pompidou…) , mais cette fois-ci pas seulement régulé d’un point de vue social (ce à quoi avait renoncé le social-libéralisme), mais aussi écologique ? Je crains que la juxtaposition d’un refus de cette dernière idée et d’un pessimisme sur la possibilité d’abolir le capitalisme n’aboutisse en fait à une position simplement protestataire doublée d’un activiste « trade-unioniste » dans les domaines sociaux et environnementaux.
3. Nos meilleurs réformistes
Mais tu acceptes ensuite de travailler l’hypothèse de la « possibilité d’avancées » et t’interroges sur les « conditions ». Et tu réponds classiquement : « Ok pour un front uni avec les réformistes, mais sous l’hégémonie des révolutionnaires » (je résume…).
Sur le principe je suis d’accord. Mais s’agissant du cas particulier du texte Viveret, c’est un peu le marteau-pilon du léninisme pour tuer la mouche Viveret-JB de Foucault. Si j’étais partisan de signer, c’était au nom du principe : « Quand on veut travailler avec quelqu’un , il faut lui faire de petits plaisirs », le détail du texte n’avait aucune importance, personne ne le lira.
Reste que l’application trop mécanique de ce principe d’hégémonie préalable peut aller trop loin. Nous ne regrettons pas d’avoir participé en position de faiblesse à la majorité plurielle de 1997 à 2000 (après, la période Fabius, ça se discute). Nous avons pu faire passer des trucs (comme la parité et les 35 heures, que Jospin refusait encore dans son discours d’investiture). Ce n’est pas seulement une position « possibiliste » (encore qu’il faille distinguer le « possibilisme » qui minimise le possible, et le possibilisme qui engrange tout ce qu’on peut gratter). Mais c’est l’idée qu’il faut commencer à agir pour grossir, que l’hégémonie ça se conquiert dans la lutte contre l’ennemi commun. Le PC Chinois était plus petit que le Kuomintang au début du front uni anti-japonais, le PCF deux fois plus gros que le PS à la signature du Programme commun. Apres… le plus futé (ou le moins Kun) a gagné…
Les réformistes radicaux comme les anti-libéraux étaient faibles, divisés. Ce n’est pas en disant « Nous sommes faibles, donc on ne fait rien avec les réformistes d’accompagnement, on les critique » qu’on va grossir et s’unifier, mais en proposant des objectifs ambitieux et en montrant notre disponibilité à travailler pour avancer dans leur direction. Ce n’est pas l’organisation des forum de Libération qui marginalise les idées révolutionnaires, mais, comme tu le dis très bien, l’incapacité des « anti-libéraux « à sortir d’autres propositions que le vieux discours étatiste.
Je n’en suis que plus surpris de te voir conclure « En bref, il me paraît plus aisé d’assouplir un républicain rigide que de radicaliser un libéral-libertaire. » Il faudrait regarder au cas par cas. Je constate que DCB a fait une campagne très à gauche (en fait la plus à gauche de toutes celles que j’aie faites avec les Verts depuis Voynet 1995, et les résultats furent au rendez-vous, en particulier dans les classes populaires : cf http://lipietz.net/?article2458)
EE s’est beaucoup investi dans la campagne sur les retraites. Inversement, je n’y ai pas vu les « républicains » de Chevènement (mais j’y ai vu Mélenchon, grand défenseur de Maastricht, c’est vrai, et coté fédéralisme européen, il s’est plutôt rigidifié.)
Mais je note que, contrairement à ta première réponse, la comparaison est avec les « républicains » et non plus avec les « souverainistes ». On converge !
4. Sur l’Union européenne.
Ah ! c’est une longue bataille qui mérite une discussion spécifique. J’ai tenté de la résumer ici, pendant la négo de Lisbonne : « Les tribulations de l’Europe politique », http://lipietz.net/?article2090 .
Nous avons eu la possibilité de nous saisir de la proposition de TCE pour un Oui de combat, contre Barroso, Mc Greavy, Bolkestien, qui depuis Rome étaient sur la ligne « Nice ou la mort » (cf http://lipietz.net/?article1164). Vous (nonistes de gauche) avez choisi et obtenu une autre voie : bloquer le processus au nom d’un plan B que vous n’avez jamais énoncé et n’aviez aucun moyen de contrôler. Le plan B a donc été avancé par Merkel et Socrates, c’est Lisbonne. Je l’ai voté, parce que c’est toujours mieux que Maastricht-Nice… mais moins bien que le TCE.
Mais comme tu le dis justement , il y a une différence entre la « logique de Lisbonne sur la papier » (plus fédéraliste, plus social, plus droit des femmes, plus écolo que Maastricht-Nice) et la pratique qui s’est instituée dans la terrible période 2005-2009, où les gouvernements de droite (et les populistes) ont surfé sur le rejet du Tce pour imposer une pratique toatalement intergouvernemantaliste, donc souverainiste et donc ultra-libérale.
Lisbonne finira peut –être par tenir ses « promesses de papier ». Mais il faudra des victoires de la gauche pays par pays, et des mobilisations populaires européennes utilisant ses « promesses » (par exemple le droit d’initiative législative par pétition, ou les pressions directes des paysans sur le Parlement qui va enfin, grâce à Lisbonne, voter sur la PAC, ce qu’a compris –un peu tard -José Bové).
5. Sur le stalinisme
Nous sommes donc d’accord, le stalinisme nous a plus pourri la vie militante que le fascisme (depuis la fin de l’Occupation, évidemment). Et d’accord que l’usage par Furet du concept de « totalitarisme » fut scandaleux, car il revient à dire que les staliniens d’opposition (les communistes français des années 70 par exemple) étaient aussi coupables que les staliniens au pouvoir (Honecker ou Brejnev). Il y a une différence fondamentale : la plupart des premiers (mais pas tous) étaient communistes par engagement généreux, avec des idées démocratiques, la plupart des seconds (mais pas tous) martyrisaient leur propre peuple pour leurs propres intérêts de classe dominante.
Il ne faut pas pour autant balayer l’idée même de caractères communs entre fascisme et stalinisme, rassemblés sous le concept de « totalitarisme ». Non pas opposé, selon Furet, au libéralisme économique (quoique je pense qu’un « socialisme monopoliste d’Etat » soit presque nécessairement dictatorial, il faudra discuter ce point entre nous). Mais bien, selon H Arendt, au libéralisme politique, à la démocratie libérale au sens de Mc Pherson (l’acceptation et même la valorisation du dissensus, le refus de l’idée d’un « peuple » homogène opposé aux ennemis et aux traitres ).
Sa version de gauche, le totalitarisme spontané du militant populaire, je l’ai connue aussi, et elle continue à m’inquiéter. Tu me fais la gentillesse de reconnaître que mon « Oui au Tce » n’était pas forcément criminel. Tous n’ont pas eu cette subtilité à mon égard, mais encore bien moins à l’égard de la citoyenne lambda qui n’avait d’autre argument que la comparaison des deux traités en lice et trouvait bêtement que le Tce c’était mieux que Nice. Trois enseignantes, progressistes, du lycée d’une petite ville m’ont raconté qu’elles ont dû manger à une table isolée à la cantine, pendant six mois, parce qu’elles votaient Oui. J’ai été formé à « oser aller à contre courant », mais tou-te-s n’avaient pas cette chance.
Salut donc , cher Roger, et fraternité.
Mardi 25 janvier 2011 à 12h18mn44s, par Alain Lipietz
lien direct : http://lipietz.net/?breve413#forum3867
-
Effectivement Alain, cela fait du bien de débattre.
1. Sur la caractérisation de la crise, je pense que nous cernons mieux ce qui nous rapproche et ce qui nous sépare. Ce qui nous rapproche est la volonté de dépasser le mécanisme qui, du primat des forces productives, conduit presque inexorablement, via la révolution prolétarienne, à la vision d’une société enfin réconciliée avec elle-même, où l’égalité et l’abondance se conjuguent à l’infini. Alors que ma culture initiale, un tantinet scientiste, me conduisait à penser mordicus que la science règlerait peu à peu les dégâts collatéraux du progrès, je considère aujourd’hui que les stocks dont dispose l’ingéniosité humaine ne sont pas éternels et que les écosystèmes ne se « réparent » pas comme une machine. Dans le dispositif imbriqué des crises actuelles, la crise écologique n’occupe donc pas, dans ma pensée, la place subalterne que je lui aurais sans doute attribuée il y a quelques décennies. Mais pas moins subalterne aujourd’hui que la crise démocratique (le dérèglement des procédures de détermination des choix et d’allocation des ressources) ou que la crise anthropologique (le dérèglement des finalités que les hommes assignent à leur vie personnelle et aux collectifs dans lesquels ils s’insèrent).
D’une manière ou d’une autre, toutes les sociétés sont confrontés aux mêmes impératifs écologiques, mais les manières dont elles se structurent, se meuvent et se pensent n’est pas pour rien dans la manière dont elles traitent les équilibres de l’homme et de la nature. On ne traite pas la question de la richesse-Terre de la même manière dans des sociétés déchirées par les inégalités et des sociétés de redistribution assumée, dans des sociétés d’appropriation privative ou dans des contextes de mise en commun, dans des sociétés où l’accumulation des biens matériels est une valeur en soi ou dans celles où le développement de la personne prime sur tout autre impératif. Si l’on veut préserver le patrimoine des générations futures, je trouve donc plus pertinent, plus réaliste et plus propulsif de partir de l’hypothèse selon laquelle la fin tendancielle de l’aliénation (et donc de l’exploitation et de la domination) sont une condition durable d’un développement maîtrisé. Tu sais parfaitement que l’hypertrophie, dans l’imagerie du « développement durable », du pilier « environnemental » par rapport au pilier « social » conduit de fait dans l’impasse environnementale, dont les tensions Nord-Sud ne sont que la forme exacerbée.
Est-ce un désaccord ? Tu penses que je récuse la centralité de la crise écologique au nom d’une priorité ancienne du social. Je pense au contraire que l’universalisation de la forme-capital et la recomposition des « instances » classiques (la dilution des frontières de l’économique, du social, du politique…) rend caduque la recherche du chaînon central. À la fois plus individuelles et plus mondialisées, les sociétés modernes se pensent et se travaillent dans leur universelle interconnexion. Si de la dynamique, du partage, des alliances doivent se nouer, c’est sur le terrain d’une globalité transformatrice recherchée, revendiquée, façonnée. Faute de quoi, nous courrons d’une crise à l’autre, d’un dysfonctionnement à l’autre, d’une priorité à l’autre. Et, à l’arrivée, nous pourrions bien avoir la barbarie…
2. Faut-il penser un capitalisme « préférable » ? Franchement, cette question ne m’intéresse guère. Non pas que ne me préoccupe pas que le capitalisme soit plus ou moins insupportable. Je te l’ai déjà dit : la politique du pire n’est pas de ma culture. Il y a des urgences, aussi bien environnementales que sociales, qui ne supportent pas que l’on reporte à l’au-delà de la « révolution » la recherche de solutions immédiates. Le visage concret pris par la gestion capitaliste dominante ne m’est donc pas indifférent. Faut-il pour autant nous fixer l’objectif d’un capitalisme « à visage humain ? Je ne le crois pas. Sans doute suis-je plutôt enclin à penser que le capitalisme est engagé dans une longue crise systémique, avec des périodes plus ou moins mobiles et conflictuelles, qui verront alterner des phases plutôt dérégulatrices et des phases plutôt régulatrices. Mais peu importe ici… ce qui compte est que je ne crois pas qu’un sustainable capitalism se pense : il se construit pragmatiquement, non pas sur la base de modèles intellectuels, mais d’équilibres précaires de forces sociales globales.
Et dans ces équilibres, je persiste à penser que le plus décisif est la place qui est attribuée aux cultures-mouvements de l’alternative sociale. Une société « révolutionnée », reposant sur d’autres finalités collectives, d’autres critères d’efficacité globale, d’autres méthodes d’allocation des ressources, d’autres procédures de choix serait en fait plus « réaliste » que les sociétés d’aliénation. Il faut agir toujours pour penser et construire la dynamique tendant vers cela. Cela signifie à la fois de la contestation (on conteste un par un les choix du capital, dans tous les domaines ; on retourne contre lui ses propres règles ou lois), de la capacité à infléchir les normes (commencer de changer la règle du jeu) et de l’invention alternative proprement dite, de la capacité concrète à faire du commun autrement que par la voie du marché ou par celle de l’État administratif (dans le service public ou dans l’économie sociale et solidaire). Le premier niveau ne dépasse pas l’horizon de la « bonne » social-démocratie d’antan ; le second porte vers un réformisme plus radical (post-keynésien) ; le troisième est plus franchement alternatif ou visionnaire (et pourtant diablement concret…).
En faisant cela, on travaille au changement anthropologique possible (le post-capitalisme). Et, dans l’immédiat, on crée la possibilité d’un capitalisme partiellement « humanisé ». Pas de réforme pensable sans révolutionnaires incrustés dans la vie sociale : ma formule, pour être aussi provocatrice que ton capitalisme « préférable », ne m’en paraît pas moins pertinente.
3. Quand on construit des alliances, on ne se prépare pas à des lendemains radieux, mais à de lourdes contradictions, quels que soient les partenaires retenus. Bâtir des réseaux durables ne signifie pas vivre entre soi et ne se tourner vers le monde que quand on est devenu hégémonique. L’expérience historique (celle en tous cas du vieux mouvement ouvrier) est que, à ce jeu-là, on peut attendre très longtemps. Mais l’essentiel est au départ de se dire, non pas quelle est la muraille qui sépare, mais quelle est la ligne au demeurant mobile qui sépare les réseaux d’alliances. Pour l’instant, et à mon avis pour une très longue période, cette ligne me paraît se situer dans le rapport au libéralisme réellement existant et au parti pris de rupture tendancielle avec le système dominant.
Tu as eu raison de noter que je suis passé de la référence au « souverainiste » à l’évocation du « républicain ». Le souverainisme ne me paraît pas un système mais un prurit : le reflet inversé d’une universalisation perverse et destructrice (celle de la marchandise) et le signe d’une carence historique (celle d’un universalisme réaliste de la mise en commun). À la limite, discuter du souverainisme ne sert à rien : on ne discute pas avec un postulat. En revanche, la culture républicaine de pente étatiste est à la fois un objet qui vient de loin et une pensée reproductible, d’autant plus tentante que l’on ne connaît pratiquement pas d’autres régulateurs globaux que le marché et l’État. Face au mariage du contrat et de la concurrence libre et non faussée, quoi de plus immédiatement rassurant que les épousailles de la loi et de l’intérêt général ? Mais si je pense que la pente étatiste est un piège pour la « chose publique » elle-même, je n’ai nulle envie de combattre les « républicains » en m’appuyant sur les « libéraux » ou même les « libéraux-libertaires ». C’est au nom de la conception moderne et plurielle de la mise en commun et donc au nom d’une conception renouvelée du « public » (non marchande et non étatiste) que j’entends faire reculer l’étatisme « progressiste » d’hier. Ou alors, se produit un brouillage qui, à l’arrivée, produit de l’inefficacité et de la défaite… face au capital.
Voilà, on en restera là pour aujourd’hui. Pour le stalinisme on verra plus tard…
Salut et fraternité (si j’étais un bon jacobin, j’ajouterais : « dans l’unité et l’indivisibilité de la République », mais, bon, ça ne se fait plus je crois…)
Roger Martelli
Mardi 25 janvier 2011 à 17h22mn13s, par Roger Martelli
lien direct : http://lipietz.net/?breve413#forum3868
-
Moi qui ne suis pas, et n’ai jamais été, un politicien professionnel (et ce mot ne doit surtout pas être considéré comme péjoratif !), lorsque je lis : "Moi qui me suis donné entièrement à la justification d’un non de gauche au TCE, un Non à l’Europe libérale PRÉLUDE D’UN OUI à l’Europe sociale, démocratique et écologiste…", je me demande si nous vivons dans le même monde.
Quand on voit les résultats constants des élections LIBRES dans les pays européens, il ne s’agit pas de prélude mais de fugue (dans son sens de "fuite", bien sûr) !
Quels gens stupides ces Tchèques, ces Hongrois, qui votent pour la droite nationaliste et (ultra) libérale quand il leur suffirait de voter pour les candidats de l’Europe sociale, démocratique et, accessoirement, écologiste. Voilà ce qui arrive quand "on" cesse d’éclairer le choix des électeurs…
À propos de Poher vs Pompidou et Chirac vs Le Pen, en 2012, si nos amis de la vraie Gauche (i.e. Mélanchon et Besancenot) font un "bon score", Sarkozy vs Marine Le Pen, ce serait comme Poher vs Pompidou ou comme Chirac vs Le Pen ?
Mardi 25 janvier 2011 à 04h18mn43s, par Joke
lien direct : http://lipietz.net/?breve413#forum3866
|
|