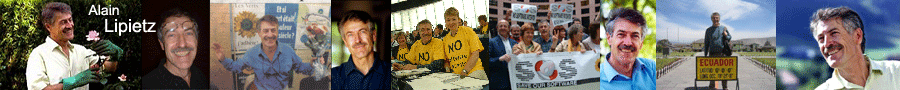-
Syndiquez-vous
-
 Articles
Articles
-
 Blogs
Blogs
-
 Forums
Forums
-

par Alain Lipietz | octobre 2006
La Revue parlementaire, Dossier spécial
L’économie sociale et solidaire : nouvelle frontière pour l’Europe ?
 |
C’est au début des années 1980 qu’est apparue l’expression « tiers secteur ». La promotion de ce secteur était inscrite dans l’accord PS-Verts fondant la majorité plurielle de 1997-2002. En 1999, la ministre Martine Aubry me demanda un rapport sur les formes de ce secteur. Il fut décidé de l’appeler « Economie sociale et solidaire ». Malgré la remise du rapport [1] et la nomination d’un secrétaire d’Etat , il ne fut guère donné plus de soutien à ce qui existait déjà. |
Car il s’agit d’une vieille histoire. Parler de « tiers secteur » suppose deux autres secteurs : le privé et le public, définis respectivement par les principes d’échange et de redistribution. Or dans toute société domine ce que les anthropologues appellent « principe de réciprocité » : on travaille pour la communauté, avec la conscience qu’on lui doit quelque chose et qu’elle assurera vos besoins. Ce principe gouverne, depuis toujours, la famille.
La Révolution de 1789 a établi la suprématie de l’Etat et de l’entreprise privée, la famille et les Eglises se voyant toutefois reconnaître un certain rôle. Aussitôt, le mouvement ouvrier naissant a cherché à créer ses propres organisations pour satisfaire ses besoins. Sont nées les mutuelles, simples dépôts d’argent, les coopératives, organisations d’achat ou de production en commun, et les associations, incluant toutes formes d’activités. C’est ce que Charles Gide, en 1900, appela « l’économie sociale », dans laquelle il incluait d’ailleurs les œuvres sociales des entreprises et de l’Etat.
Aujourd’hui, la sécurité sociale (organe public et obligatoire) comme les syndicats (organes de lutte) sont clairement distingués de l’économie sociale, mais l’expérience des avancées et retraits successifs de « l’Etat-providence » montre la malléabilité de ces frontières. Comme l’avaient senti Jean Jaurès, une organisation de défense populaire tend toujours à faire reconnaître son travail comme un service « au public » justifiant rémunération et statut, tout en refusant d’être assimilée à une administration.
Cette histoire vaut en fait pour toute l’Europe, mais la distinction entre les différentes formes légales varie d’un pays à l’autre. C’est une des difficultés de la reconnaissance du tiers secteur à l’échelle de l’Union européenne, où l’on parle à présent de « Services d’intérêt économique général à vocation sociale ».
Un débat extrêmement complexe se développe à la Commission et au Parlement européen sur la nécessité d’inclure ou non ces « SIEGS » dans le champ de la directive Services (ex – « Bolkestein ») et même dans la directive spécifique aux SIEG (services publics) que prévoyait l’article 122 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe.
L’économie sociale et solidaire reste en effet difficilement réductible aux principes régissant les entreprises privées comme au secteur public, pour au moins deux raisons.
En tant qu’économie « sociale », elle représente une certaine façon de produire. La gouvernance obéit au principe : une personne, une voix ; le résultat d’exploitation doit être réaffecté au même but social, la rémunération des participants étant strictement limitée.
En tant qu’économie solidaire, elle vise à engendrer, autour de produits précis, un « halo » d’effets sociétaux profitables à l’ensemble de la société, sans faire pour autant l’objet d’une transaction. L’existence de ce halo justifierait l’existence d’une subvention (ou d’une dispense d’impôt), puisque, par ses effet non directement rémunérés, l’économie solidaire accroît le bien-être collectif (symétriquement aux activités polluantes, qui, engendrant des effets sociaux négatifs, justifiant le paiement d’écotaxes).
L’Union européenne, qui se définit « économie sociale de marché », saura-t-elle se reconnaître « économie plurielle avec marché » reconnaissant l’originalité et la place de l’économie sociale et solidaire ?
Sur le Web : La Revue Parlementaire


-
[18 juillet 2014]
Gaza, synagogues, etc

Feu d’artifice du 14 juillet, à Villejuif. Hassane, vieux militant de la gauche marocaine qui nous a donné un coup de main lors de la campagne (…)
-
[3 juin 2014]
FN, Europe, Villejuif : politique dans la tempête

La victoire du FN en France aux européennes est une nouvelle page de la chronique d’un désastre annoncé. Bien sûr, la vieille gauche dira : « (…)
-
[24 avril 2014]
Villejuif : Un mois de tempêtes

Ouf ! c’est fait, et on a gagné. Si vous n’avez pas suivi nos aventures sur les sites de L’Avenir à Villejuif et de EELV à Villejuif, il faut que (…)
-
[22 mars 2014]
Municipales Villejuif : les dilemmes d'une campagne

Deux mois sans blog. Et presque pas d’activité sur mon site (voyez en « Une »)... Vous l’avez deviné : je suis en pleine campagne municipale. À la (…)
-
[15 janvier 2014]
Hollande et sa « politique de l’offre ».

La conférence de presse de Hollande marque plutôt une confirmation qu’un tournant. On savait depuis plus d’un an que le gouvernement avait dans (…)
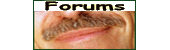
-
[11 mai 2016]
Dans l’état où nous sommes...
Allergique à Fesse-bouc je me permets de commenter ici votre article "Dans (…) -
[17 décembre 2015]
Cliquez sur le smiley choisi
May I just say what a comfort to discover an individual who genuinely knows (…) -
[18 juillet 2015]
Démocratie grecque
Cher Joke, dernier dialoguiste de ce site (qui reste très lu) Je ne dis pas (…) -
[9 juillet 2015]
Démocratie grecque
Puisque je suis sur votre blog, pour les félicitations, je vais en profiter (…) -
[9 juillet 2015]
Gaza, synagogues, etc
Félicitations aux mariés ! Et longue vie (militante) ensemble. (Je renonce à (…)

- 2006
-
[8 décembre 2006]
Propositions pour une politique réellement efficace en matière de développement durable -
[23 novembre 2006]
L'Europe, telle que nous l'avons perdue -
[8 novembre 2006]
Qu'elle serait verte ma cité ! -
[octobre 2006]
L’économie sociale et solidaire : nouvelle frontière pour l’Europe ? -
[11 septembre 2006]
La campagne d'une historienne - Économie
-
[25 septembre 2024]
Les Jeux olympiques et paralympiques, théâtres de la Comédie humaine -
[15 April 2019]
Monetary policy in time of climate crisis -
[15 avril 2019]
Capitalisme et écologie, vraiment ? -
[23 septembre 2015]
L’alternative est européenne ou ne sera pas -
[2015年8月17日]
グリーンディールー自由主義的生産性至上主義の危機とエコロジストの解答 - Tiers secteur
-
[24 novembre 2024]
L'économie sociale et solidaire : origines et principes -
[22 mars 2022]
Face à la toute-urgence écologique : la Révolution Verte -
[28 novembre 2020]
Comment ceux qui luttent pour la planète prennent-ils en compte les personnes qui attendent avec inquiétude la fin du mois ? -
[26 juillet 2017]
La vérité sur la loi Le Chapelier -
[8 juillet 2017]
Économie sociale et solidaire, mouvements sociaux et écologie. Le cas français.

-
[2 février 2026]
Deux rêves de femmes chez Mallarmé : Petit Air, Le Nénuphar blanc -
[20 December 2025]
The Adoption of the Social Security Financing Bill: First Lessons -
[15 décembre 2025]
L’adoption du PLFSS 2026 : premières leçons -
[12 décembre 2025]
Vasco de Gama, Magellan : les Portugais à la conquête du Monde -
[6 décembre 2025]
Quatre films sur le Vendredi 13 novembre 2015