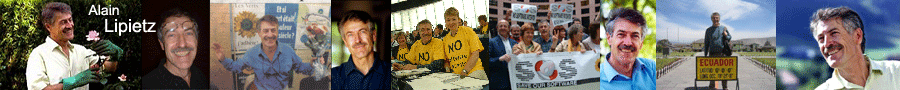-
Syndiquez-vous
-
 Articles
Articles
-
 Blogs
Blogs
-
 Forums
Forums
-

votre référence :
[1996t] " Globalisation, mondialisation, concurrence : la planification française a-t-elle encore un avenir ? " (avec D. Voynet), Colloque pour le Cinquantenaire du Commissariat Général du Plan, Sorbonne, 23-24 Mai.
(art. 329).par Alain Lipietz , Dominique Voynet | 23 mai 1996
Globalisation, mondialisation, concurrence
La planification française a-t-elle encore un avenir ?
Colloque pour le Cinquantenaire du Commissariat Général du Plan
|
[1996t] " Globalisation, mondialisation, concurrence : la planification française a-t-elle encore un avenir ? " (avec D. Voynet), Colloque pour le Cinquantenaire du Commissariat Général du Plan, Sorbonne, 23-24 Mai.
|
Les écologistes, comme la plupart des économistes et des sociologues de bon sens, reconnaissent la nécessité d’un pluralisme dans les modes de production (salariat public, privé ou coopératif, petite production autonome, entraide de voisinage, activité domestique) comme dans les modes de régulation : marché, règlements, conventions,... et planification publique.
Durant cinquante ans, en France, cette dernière s’est illustrée sur deux volets.
Le premier, le plus connu et auquel on a eu trop tendance à réduire "le Plan", c’est la détermination raisonnée des grands projets d’équipement, des grandes infrastructures publiques.
Le second, qui fait l’originalité de la "planification à la française" héritée de la Libération de 1945, c’est l’existence d’un lieu permanent de dialogue entre les groupes sociaux, pour la construction d’un certain consensus national sur le modèle de développement à adopter, par delà les divergences sur les rythmes et sur le partage des bénéfices de l’activité commune.
Ni l’une, ni l’autre de ces missions ne nous semble devoir être remise en cause par la "globalisation". Bien au contraire, celle-ci appelle un surcroît de réflexion et de concertation au niveau national (comme d’ailleurs, tout aussi bien, au niveau régional !)
La société a plus que jamais besoin de se concerter, de préparer les choix majeurs, pour s’insérer dans le tourbillon de l’économie mondialisée, de la manière la plus conforme à l’harmonie sociale (au sein de la génération présente) et au respect des droits des générations futures : ½ que l’on appelle aujourd’hui développement soutenable. Le Plan, plus que jamais, doit revenir à la définition qu’en donnait Pierre Massé : un réducteur d’incertitude.
Pour la simplicité de l’exposé, nous examinerons successivement les deux volets de la mission du Plan, et ferons à chaque fois des propositions.
I - LE PLAN, INITIATEUR DES GRANDS PROJETS
A la Libération, la France était encore plus dépendante de l’extérieur qu’aujourd’hui. Tout était à rebâtir, avec une "contrainte extérieure" de fer : les crédits du Plan Marshall. Du besoin de planifier la Reconstruction est né le Plan. L’ambition était l’édification d’une économie nationale relativement autonome.
D’un point de vue écologiste, on peut critiquer les choix qui ont été faits, encore que l’on ne puisse critiquer les planificateurs de l’époque pour être restés sourds... à une contestation écologiste alors quasi-muette ! Mais on ne peut arguer de ce que l’économie se soit aujourd’hui ré-internationalisée pour en déduire qu’il n’y ait plus à planifier les grands projets à l’échelle d’un pays (ou, encore une fois, d’une région). Que signifieraient alors les discours sur la subsidiarité ?
En réalité, le démantèlement du rôle du Plan à partir des années 1970 fut un processus endogène à la société française, à son "mode de gouvernance". Successivement, de Grandes Entreprises Nationales (EDF, SNCF, Compagnie Nationale du Rhône...), filles du Plan, se sont émancipées de lui, puis de grands monopoles privés ou semi-publics se sont constitués en lobby nouant des alliances féodales avec ces "Etats dans l’Etat". Les grands ministères techniques (Equipement, Industrie, Agriculture) sont eux-mêmes devenus des principautés négociant directement avec le Grand Argentier : le ministère des finances. Les accords internationaux (construction européenne, GATT) n’ont fourni qu’une rhétorique à la privatisation technocratique de ces corps de l’Etat, ou des monopoles issus de lui, devenus indépendants, et n’ayant bientôt même plus à payer un tribut verbal à leur "mission de service public".
Ainsi, de manière très technocratique mais non "planifiée", se sont imposés : le tout-électrique et le tout-nucléaire, le tout-automobile et le tout-autoroute, le tout-TGV contre les lignes secondaires, etc. Sans parler de projets farfelus et ruineux, surgis on ne sait d’où, malgré la discrète réprobation de la plupart des organes d’expertise publique : tels la filière sur-régénératrice ou le Canal Rhin-Rhône. Et nous n’évoquons même pas les grands chantiers qui n’ont pas émergé, faute que leur utilité sociale ait été affirmée et que le Plan leur ait donné le sceau de "l’ardente obligation" : énergies renouvelables, transports en commun urbains, ferroutage, etc.
Notre proposition
– Le Plan doit redevenir le chef d’orchestre des grands-projets matérialisant, sur le territoire français et par subsidiarité, les engagements de l’Union Européenne pour "l’Impératif Environnement" et les engagements du Sommet de Rio pour le Développement Soutenable.
– Cette planification nationale doit s’articuler de manière permanente avec la planification régionale, conformément à l’esprit de la réforme de 1982, mais avec plus de moyens et selon un échéancier plus raisonnable.
– Concrètement : d’où que viennent les propositions de "grands chantiers" (Plan-câble, Canal Rhin-Rhône, grandes plate-formes multi-modales, réseaux de transports d’importance nationale ou européenne), elles doivent passer par le filtre du Plan qui doit être comptable, devant le Parlement, de la qualité de leurs études d’impact, social, écologique, financier, et en matière d’aménagement du territoire.
– La coordination du système national-régional de planification et de la DATAR doit être placée sous la responsabilité d’un ministre de haut rang, ayant la co-tutelle de la Direction de la Prévision.
– Les conflits éventuels avec la Direction du Trésor doivent être tranchés au niveau gouvernemental. Le Commissaire au Plan, gardien de "l’ardente obligation", disposera d’un droit de critique publique, ce qui implique sa stabilité après le vote du Plan par le Parlement.
II - LE PLAN, ARTISAN DU CONSENSUS
Loin d’avoir homogénéisé les préférences nationales, la globalisation de l’économie s’est appuyée sur les différences nationales et a révélé l’inégale efficacité des trajectoires nationales. Les "pays qui gagnent" en terme de compétitivité structurelle de la nation ne sont nullement les pays anglo-saxons où a triomphé la dérégulation et la concurrence individualiste, mais les pays du "capitalisme rhénan" ou de "l’Arc Alpin" -Italie du Nord incluse, ou encore le Japon, ou même la Corée. Autant de sociétés où prévaut une culture de "réciprocité" et de "partenariat" en face des difficultés communes. Les Français s’émerveillent de ces succès, invoquant un héritage culturel... alors que ces modes de "gouvernance" efficients sont cristallisés dans des institutions.
La France disposait de ce type d’institutions : le Plan, le Conseil Economique et Social, et les a laissé dépérir. Pourtant, ils n’avaient pas démérité. Dans les commissions du Plan se sont testées, rodées, pendant les Trente Glorieuse, des démarches communes, des procédures d’arbitrage entre groupes sociaux, et finalement une vision commune du Progrès, cadrant de possibles compromis pour les crises les plus graves.
Encore une fois, on peut critiquer la conception du Progrès prévalant à l’époque. Il s’agissait de "partager les fruits" d’une croissance exclusivement matérielle que l’on voulait la plus rapide possible. Il s’agit aujourd’hui de s’accorder sur les modalités d’un développement soutenable, au double sens du mot : assurant bien-être et dignité pour tous, aujourd’hui, en résorbant la "fracture sociale", et respectant les intérêts des générations futures.
Telle n’est certes pas le credo d’une "pensée unique" à dominante anglo-saxonne. Ce n’est pas un hasard si des écoles de pensées plus soucieuses de l’intérêt général et de l’harmonie sociale (écoles post-keynésiennes, théorie de la Régulation) ont pu se développer au sein de centres de recherche étroitement liés au Plan (Cepii, Cepremap...) et ont su offrir, à ceux qui voulaient encore penser la sociabilité française, quelques outils intellectuels.
Où donc a-t-on pu voir, si ce n’est dans les commissions du XIe Plan, patronat, syndicats, écologistes, discuter pendant de longs mois de la réduction du temps de travail ou de la prévention de l’effet de serre, convoquer experts et modèles économétriques, pour parvenir quand même, de mouture en mouture, à des textes fragiles mais unanimes, ébauchant d’éventuels compromis après avoir fait le tour des divergences ?
Saurons-nous éviter qu’au nom de la globalisation soit balayée toute réflexion visant à prévenir la dislocation d’une communauté d’hommes et de femmes qui, tant bien que mal, respectent encore une certaine légalité républicaine, parce qu’ils s’accrochent encore à la foi en un avenir commun et mutuellement avantageux ? Si oui, cela passera par un lieu d’observation et de débat permanent, dont la "Planification à la française" a fourni le modèle. Elle ne demande qu’à redevenir elle-même.
Nos propositions
– Le Commissariat Général du Plan doit devenir à la fois l’observatoire général de la fracture sociale et la tête pensante du développement soutenable.
– Pour cela, les centres d’analyses et de recherche liés au Plan doivent être soutenus et convenablement incités à répondre à la demande sociale qui s’exprime dans le débat public, à éclairer les grands enjeux de société. Un centre particulièrement précieux comme le CERC doit renaître de ses cendres et être rattaché au Plan.
– Le Plan doit se réhabituer à travailler avec les centres d’expertise d’autres administrations, qui sont aussi de fort bonne qualité, et avec des équipes universitaires. Pour cela, et indépendamment des crédits de fonctionnement du Plan et ses centres satellites, il faut rétablir une enveloppe de recherche orientée, du type de l’ancien CORDES.
– Les commissions du Plan se réunissent en général trop tardivement et n’ont pas le temps de lancer des études. Sans aller jusqu’à la pérennisation des commissions, qui aboutirait à les vider de tout sens de l’urgence et de l’obligation de résultat (risque qui pèse, à l’autre extrême, sur le Conseil Economique et Social), il convient de redonner à la négociation sociale au sein des commissions toute l’ampleur, et donc les moyens, que justifient les mutations en cours, à l’aube du XXIè siècle.


-
[18 juillet 2014]
Gaza, synagogues, etc

Feu d’artifice du 14 juillet, à Villejuif. Hassane, vieux militant de la gauche marocaine qui nous a donné un coup de main lors de la campagne (…)
-
[3 juin 2014]
FN, Europe, Villejuif : politique dans la tempête

La victoire du FN en France aux européennes est une nouvelle page de la chronique d’un désastre annoncé. Bien sûr, la vieille gauche dira : « (…)
-
[24 avril 2014]
Villejuif : Un mois de tempêtes

Ouf ! c’est fait, et on a gagné. Si vous n’avez pas suivi nos aventures sur les sites de L’Avenir à Villejuif et de EELV à Villejuif, il faut que (…)
-
[22 mars 2014]
Municipales Villejuif : les dilemmes d'une campagne

Deux mois sans blog. Et presque pas d’activité sur mon site (voyez en « Une »)... Vous l’avez deviné : je suis en pleine campagne municipale. À la (…)
-
[15 janvier 2014]
Hollande et sa « politique de l’offre ».

La conférence de presse de Hollande marque plutôt une confirmation qu’un tournant. On savait depuis plus d’un an que le gouvernement avait dans (…)
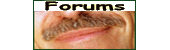
-
[11 mai 2016]
Dans l’état où nous sommes...
Allergique à Fesse-bouc je me permets de commenter ici votre article "Dans (…) -
[17 décembre 2015]
Cliquez sur le smiley choisi
May I just say what a comfort to discover an individual who genuinely knows (…) -
[18 juillet 2015]
Démocratie grecque
Cher Joke, dernier dialoguiste de ce site (qui reste très lu) Je ne dis pas (…) -
[9 juillet 2015]
Démocratie grecque
Puisque je suis sur votre blog, pour les félicitations, je vais en profiter (…) -
[9 juillet 2015]
Gaza, synagogues, etc
Félicitations aux mariés ! Et longue vie (militante) ensemble. (Je renonce à (…)

- 1995 à 1999
-
[2012年9月5日]
Regulationist political ecology or economics of environment ? -
[Julho de 2003]
A ecologia politíca e o futuro do marxismo -
[1 March 2000]
Political Ecology and the Future of Marxism -
[16 décembre 1999]
Epargne salariale et retraites.Une solution mutualiste -
[septembre 1999]
La valeur travail en débat - Économie
-
[25 septembre 2024]
Les Jeux olympiques et paralympiques, théâtres de la Comédie humaine -
[15 April 2019]
Monetary policy in time of climate crisis -
[15 avril 2019]
Capitalisme et écologie, vraiment ? -
[23 septembre 2015]
L’alternative est européenne ou ne sera pas -
[2015年8月17日]
グリーンディールー自由主義的生産性至上主義の危機とエコロジストの解答 - Relations et politiques sociales
-
[22 mars 2022]
Face à la toute-urgence écologique : la Révolution Verte -
[17 octobre 2020]
Sortir de la crise ? -
[16 septembre 2019]
Ecologie politique des Gilets Jaunes -
[5 décembre 2018]
Écologie politique des Gilets Jaunes -
[23 June 2015]
Growth strategies, employment and job quality in a globalized world - Social
-
[15 décembre 2025]
L’adoption du PLFSS 2016 : premières leçons -
[28 novembre 2020]
Comment ceux qui luttent pour la planète prennent-ils en compte les personnes qui attendent avec inquiétude la fin du mois ? -
[5 de agosto de 2015]
Las políticas sociales en América latina : laboratorio mundial -
[10 March 2015]
Empowerment and Émancipation -
[26 janvier 2012]
Être écologiste et vieillir heureux

-
[24 novembre 2024]
L’économie sociale et solidaire : origines et principes -
[8 juillet 2017]
Économie sociale et solidaire, mouvements sociaux et écologie. Le cas français. -
[5 avril 2017]
L’Économie sociale et solidaire et l’écologie, de l’émergence antédiluvienne à la banalisation. Le cas français. -
[31 January 2014]
The Anthropological Crisis and the Social and Solidarity Economy -
[31 janvier 2014]
La crise anthropologique et l’Économie sociale et solidaire